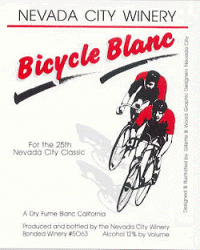Sociologie et Architecture
Sociologue de formation (et même socio-économiste), pourquoi me suis-je orienté vers l’architecture et l’urbanisme ? Hasard sans doute. Jamais je n’ai regretté cette orientation.
Dès 1970 j’ai enseigné dans une école d’architecture (Lyon). Ensuite, tout en faisant le prof d’économie en secondaire, j’ai donné des cours à l’école d’architecture de Saint-Étienne. Au bout de dix ans de cette double responsabilité, j’ai abandonné l’Éducation nationale pour ne plus travailler qu’en architecture (Lyon puis Saint-Étienne). À l’occasion, je suis intervenu quelquefois ailleurs (école des Travaux publics de l’État, Sciences-Po Lyon, CHU de St-Jean-Bonnefonds, Fac de Lettres Saint-Étienne, etc.), et j’ai parfois œuvré sur des projets ou des concours avec des agences d’architectes, pour mieux comprendre leur métier.
Si je ne devais retenir qu’un point de ma longue fréquentation des architectes, je dirai que les meilleurs d’entre eux m’ont appris un langage nouveau : celui des formes bâties, avec leur grammaire et leur lexique, et, surtout, celui du vide qui constitue les volumes (pour un édifice comme pour une ville).
J’ai la plus grande reconnaissance pour les architectes qui m’ont appris à voir le vide.
Mes professeurs de bonheur
On a toujours tort de bouder son plaisir. Et plus encore d’ignorer le bonheur.
Pendant longtemps je n’ai rien su des joies nées de l’architecture. D’abord parce que, jusqu’à l’âge adulte, personne n’avait attiré mon attention sur ce point : je suis un quidam comme un autre et on ne parle jamais d’architecture aux quidams. Ensuite parce je suis sociologue.
C’est ici que les choses se compliquent. Car je suis un sociologue spécialisé dans les questions d’architecture et de ville. Mais voilà, j’en ai longtemps parlé comme un savant qui observe son objet de l’extérieur. Les lieux matériels étaient à mes yeux des faits et des arguments. J’analysais ainsi l’économie de la production, les enjeux idéologiques des formes, les usages sociaux de l’espace, en essayant de ne pas proférer trop d’âneries sur ces sujets, mais l’architecture elle-même m’était largement inconnue.
Pas de lieux, pas de matériaux, pas de volumes : des idées. Et pas de plaisir : le plaisir est une notion suspecte en sciences humaines. J’étais un bon sociologue.
Jusqu’au jour où des amis architectes m’ont entraîné avec eux dans une visite. À Berlin. À la Philarmonie. Je me rappelle que le matin était encore gris, qu’il y avait peu de monde dans les rues de ce qui était alors un bord un peu désolé de Berlin Ouest, et que l’extérieur du bâtiment de Scharoun m’a déçu. Ces formes tarabiscotées, cette peau brillante : on m’avait fait lever tôt pour ça ? Puis nous sommes entrés dans la salle de concert.
J’ai pris l’architecture en pleine figure. Des volumes, des lumières, des matériaux. Un espace impossible à représenter. Un univers qui exigeait une appréhension par l’ensemble du corps, contraint de se déplacer pour comprendre l’espace. Une réalité dont aucune photographie n’aurait pu rendre compte parce que l’image n’a que deux dimensions et que je touchais du doigt, ici, la présence et le pouvoir de la troisième dimension.
Cette fois, j’y étais en plein : dans des volumes emboîtés d’une façon si souveraine que le vide devenait visible et que l’espace lui-même devenait lyrique. L’architecture prenait corps, au sens précis du terme.
On ne se relève pas d’une telle révélation.
Pendant la suite du voyage, j’ai accédé à des bonheurs que je n’avais pas soupçonnés. Mies, Gropius, Bruno Taut, étaient donc autre chose que des idées, et je pouvais parcourir leurs réalisations en jouissant de leur travail exactement de la même manière que je pouvais jouir de Matisse, de Picasso, de Dos Passos ou de Garcia Marquez. L’architecture pouvait donc susciter de telles joies ? Et je les avais si longtemps ignorées ? Il ne restait qu’à rattraper le temps perdu.
C’est ainsi que j’ai vécu des émotions de lumière et de pierre, à Conques, au Thoronet, dans la crypte d’Orcival, comme dans des bâtiments contemporains (la lumière zénithale dans une bibliothèque de Kahn en Californie, un jeu d’ombres dans un temple de Wright à Chicago, un silence tout à fait particulier dans un musée de Scarpa à Palerme).
Parfois, ces bonheurs surgissent dans des endroits inattendus : quelques recoins dans l’escalade du dôme de Saint-Paul par exemple, ou l’étrangeté d’un dessous de pont autoroutier à Glasgow. Souvent, ils naissent dans des balades en ville où tous les éléments bâtis semblent s’enchaîner dans une mécanique merveilleusement exacte. Parfois même ils apparaissent dans un paysage qu’une intervention architecturale révèle si justement qu’il semble soudain chanter (c’est l’impression que j’ai eue en découvrant Sénanque par la route qui surplombe l’abbaye).
Pendant un certain temps, j’ai eu la candeur de croire que tous les architectes partageaient ces ravissements. Je ne connaissais pas encore cette catégorie d’architectes que l’architecture effraie.
Il leur faut du sûr, du récité, de l’analysé : du contrôlé. C’est ce qu’ils nomment l’intelligence. Singulière intelligence qui néglige le velouté d’une ombre et interdit la jouissance. Malheureuse intelligence qui oublie que le corps sait penser. Triste intelligence, qui manifeste une telle peur des bonheurs. Pauvre intelligence qui croit qu’un savoir universitaire doit toujours précéder la conception.
Ces esprits secs professaient dans une école provinciale où je travaillais également. J’ai plaint leurs étudiants : on n’enseigne jamais bien quand le propos se fonde sur la peur.
J’aurais préféré que ces jeunes gens rencontrent des hommes de l’art qui les aident à ressentir et à comprendre comment le beau jeu des formes peut fabriquer du plaisir. C’est pour ma part ce que j’essaie de faire, même depuis ma position excentrée de sociologue. Hélas, bien peu d’experts en sciences humaines partagent cette vue. Ils ne savent pas ce qu’ils perdent.
Je sais, moi, ce que je gagne, et à qui je le dois. Je ne remercierai jamais assez mes amis architectes d’avoir été mes professeurs de bonheur.